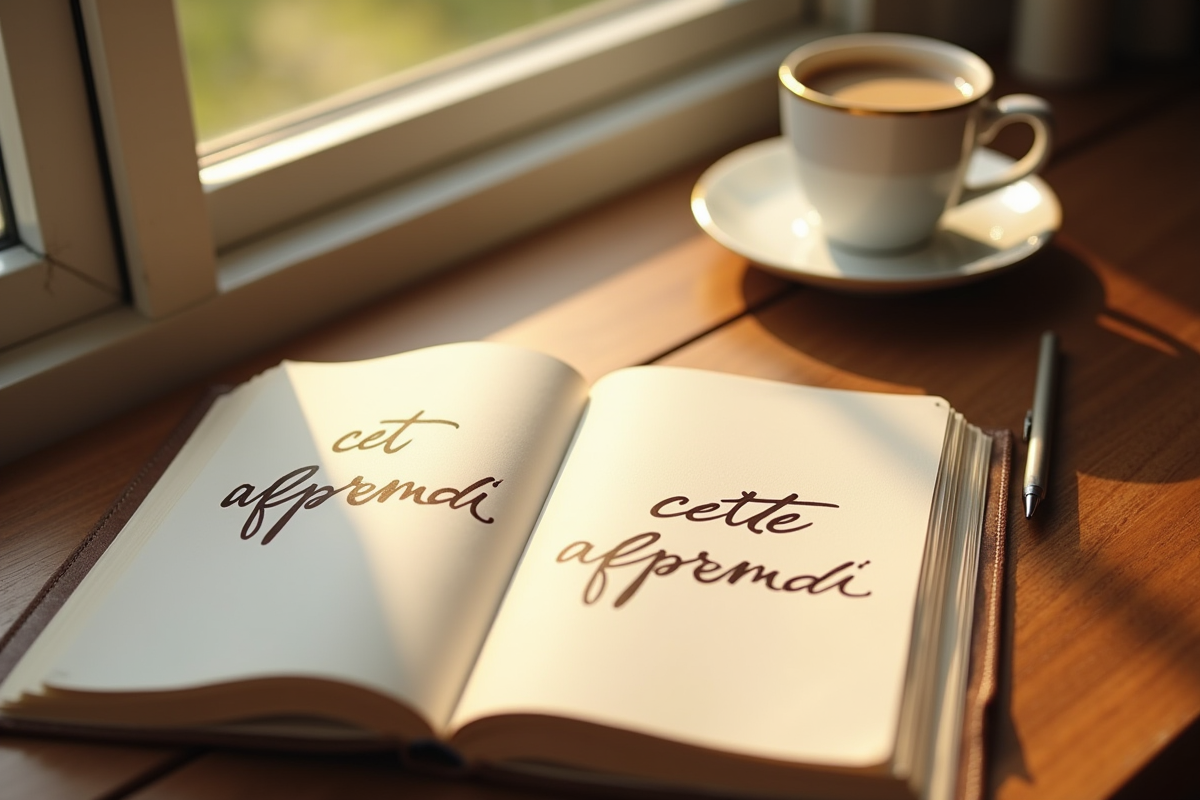Certains mots traversent les siècles sans jamais cesser de faire trébucher, même les plus aguerris. « Cet après-midi » s’affiche sans hésitation dans les grammaires, alors que, dans la rue ou à la table familiale, on entend parfois son double féminin se faufiler entre deux conversations. L’évidence des dictionnaires s’entrechoque ici avec la fantaisie de l’usage populaire.
L’Académie française campe fermement sur ses positions pendant qu’ailleurs, dans les conversations de province ou d’outre-mer, la variante féminine s’invite encore. Ce face-à-face persistant entre rigueur académique et pratiques orales réactualise sans cesse la question de la légitimité des usages dits “marginaux”.
Après-midi : masculin, féminin, ou les deux ?
Le mot après-midi intrigue, c’est le moins qu’on puisse dire. Peu de termes osent jouer ainsi sur deux tableaux. Pourtant, Le Robert et Larousse l’admettent sans sourciller : ce mot tolère (et assume) à la fois le masculin et le féminin. Dans la vie de tous les jours, le masculin s’impose : « cet après-midi, il pleuvra ». Mais dans les pages des romans, la variante féminine n’a jamais totalement disparu. Zola évoquait « une après-midi torride » ; Camus, lui, préférait « un après-midi brûlant ». D’un côté, la force de l’habitude. De l’autre, l’audace littéraire.
Pour bien comprendre cette double vie, voici comment les usages se répartissent selon les contextes :
- Masculin : il règne dans les conversations, l’administration, la presse, bref, partout où la norme s’impose.
- Féminin : il se glisse sous la plume de certains auteurs, surtout aux XIXe et XXe siècles, ou surgit dans des régions attachées à cette forme.
Ce flottement n’a rien d’accidentel. Le mot « après-midi » est formé sur « midi », masculin, ce qui devrait logiquement emporter la décision. Mais l’oreille a parfois ses raisons : « une matinée », « une soirée »… Il n’en fallait pas plus pour que des écrivains, friands de contrastes et de nuances, ouvrent la porte au féminin. Aujourd’hui, la langue française fait coexister les deux, même si l’Académie préfère la stabilité du masculin.
Choisir le genre, ce n’est pas simplement trancher entre deux formes. C’est afficher une préférence, un ancrage dans la norme ou une fidélité à la tradition littéraire. Dire « cet après-midi », c’est rester sur le terrain du plus grand nombre. Oser « cette après-midi », c’est parfois revendiquer une tonalité, une couleur régionale, ou insister sur la durée vécue.
Pourquoi l’usage hésite-t-il entre « cet » et « cette » après-midi ?
Derrière cette hésitation, il n’y a pas de hasard : c’est toute la souplesse de la langue française qui s’exprime, tiraillée entre héritage et uniformisation. Le masculin s’impose dans la plupart des échanges. L’école, les médias, les manuels scolaires l’enseignent et l’appliquent. Pourtant, les dictionnaires Le Robert et Larousse maintiennent la double option, preuve que le débat reste ouvert. Dans le Sud, dans certaines familles, la forme féminine survit, transmise de bouche à oreille. Et dans les romans, elle resurgit pour marquer la longueur d’un après-midi éprouvant ou suspendu.
Voici comment s’opère cette distinction dans l’usage :
- Le masculin cadre le moment : « cet après-midi, réunion à 15h ».
- Le féminin prolonge l’instant, marque une intensité : « cette après-midi a été éprouvante ».
La réforme de 1990 n’a rien figé. L’histoire de « après-midi » est faite de petites résistances, d’habitudes locales, d’attachement à des formes anciennes. Les écrivains s’en emparent pour donner du relief ; les enseignants, pour installer des repères. Et chacun, à sa manière, perpétue cette oscillation.
Ce que dit la grammaire française sur l’accord d’« après-midi »
L’Académie française ne laisse guère de place au doute : pour elle, le masculin prévaut. La logique ? « Midi » étant masculin, « après-midi » l’est aussi. On dira donc « cet après-midi », « un bel après-midi », notamment dans tous les contextes officiels. Ce choix n’est pas arbitraire : il s’appuie sur la structure du mot, sur la cohérence des accords en français.
Mais la littérature, là encore, ouvre la brèche. Les dictionnaires de référence, Le Robert et Larousse, n’excluent pas le féminin. Zola, Camus et d’autres ont joué avec cette liberté, et certains continuent d’en user pour colorer leurs phrases.
Quelques points précis à retenir pour éviter les maladresses :
- Le trait d’union ne se discute pas : « après-midi » s’écrit toujours ainsi.
- Le pluriel : traditionnellement invariable, mais la réforme de 1990 autorise « après-midis ».
- L’accord des articles et adjectifs dépend du genre que vous choisissez dans la phrase.
Attention, « après midi » sans trait d’union ne désigne qu’un point dans la journée, sans évoquer la notion de demi-journée. La précision orthographique fait donc toute la différence entre une simple indication horaire et l’idée d’un moment à part entière.
Pour la formule « bon après-midi », le masculin reste la règle selon l’Académie. Mais la vitalité de la langue, les influences régionales et l’attachement à la mémoire littéraire font que le féminin persiste, donnant à ce mot une souplesse rare en français.
Conseils pratiques pour ne plus douter à l’écrit comme à l’oral
Les hésitations entre « cet après-midi » et « cette après-midi » traversent aussi bien les conversations spontanées que les textes de spécialistes. Pour tout ce qui relève de l’écrit formel, il vaut mieux opter pour le masculin, privilégié par l’Académie française et omniprésent dans les publications, la presse ou l’administration. Dans cet esprit, l’article démonstratif « cet » s’impose : « cet après-midi, la réunion débutera à quinze heures ».
A l’oral et dans le registre littéraire, la liberté s’élargit. Certains préfèrent le féminin pour souligner la longueur ou l’ambiance d’un après-midi particulier. Zola écrivait « une après-midi pluvieuse » ; Camus préférait quant à lui « un après-midi d’été ». Les deux voies sont reconnues par Le Robert et Larousse, preuve que la langue sait se montrer accueillante.
Pour ne pas se tromper, voici quelques repères concrets :
- Le masculin domine dans le langage quotidien, l’administration et l’école.
- Le féminin s’invite dans la littérature, les récits personnels, ou selon certaines traditions régionales.
- Au pluriel, « après-midis » prend un « s » depuis la réforme de 1990, mais l’ancienne forme invariable reste admise.
N’oubliez jamais le trait d’union : il distingue la période de l’après-midi de la simple succession des heures après midi. Et gardez ce cap : une fois le genre choisi, alignez articles et adjectifs jusqu’au point final.
« Après-midi » reste ce mot caméléon qui dit autant la rigueur d’une règle que l’inventivité du français. À chacun de choisir sa préférence, du moment qu’il assume la cohérence des accords. On peut alors savourer la liberté qu’offre notre langue, sans jamais risquer la faute de goût.